Les silences du clinicien…
Souvent l’on reproche aux psys d’orientations analytiques de ne pas parler. En effet, face à certains patients ou à certains moment, le silence, au contraire semble empêcher d’ inviter le patient à dire. Comme s’il fallait une sorte de parole contenante pour mettre en confiance le patient, pour qu’il se sente à l’aise. Autrement dit, assurer une certaine position qui indiquerait que là une parole peut être, enfin, entendu et authentifié: quelque chose là peut enfin être reconnu. Ceci fait par exemple partie de ce qu’on nomme à tour de bras: le cadre thérapeutique.
Ainsi, j’ai longtemps pensé que cette mise en oeuvre devait passer par la parole étayante, rassurante du clinicien qui prendrait dans le transfert parental, le role d’instance nommante: un signifiant faisant advenir les autres. Cette mise en filiation se voulant faire advenir le sujet, pas celui du symptôme, mais celui du désir, est typique d’une façon de mener les entretiens avec les adolescents et jeunes adultes où le clinicien de par sa personnalité à tendance à se mettre à une place paternelle.
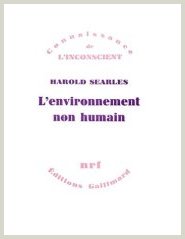
Mais voilà, si l’on ne veut pas être le maître du discours du patient, et laisser justement ce dernier entendre sa propre parole, il faut lâcher une certaine maîtrise. En d’autres termes, il n’est pas toujours possible de savoir quand fermer sa bouche et quand notre parole empêche celle du patient.
De de fait, je pensais naïvement que ce travail de juste équilibre se situait au niveau de la qualité de la parole du clinicien, c’est à dire, parler au bon moment, au bon rythme entre parler et se taire et que ceci dépendait du choix juste des mots avant de se taire.
Pourtant s’il y a une variété des paroles du clinicien, il y a surtout une variété de silences, tout les silences ne se ressemblent pas: il y a plusieurs types de silences. C’est en lisant L’environnement non-humain de H. Searles, que je me suis rendu compte de cette évidence: il y a silence et silence.
Je ne peux m’empécher de citer un passage du livre:
“C’est une illusion facile à entretenir pour l’analyste que de croire maintenue, tant qu’il garde le silence, la neutralité affective chère à la tradition analytique classique. Il aurait au contraire intérêt à se rendre compte de ce que les diverses réactions transférentielles du patient à son silence ont, selon toute probalité, un fondement significatif dans la réalité et la qualité de ce silence. [...]
J’ai maintenant la conviction que quand j’ai découvert chez un malade un conflit en grande parte inconscient sur lequel je garde un silence [...], cette découverte même transforme ma capacité de réagir ou de participer tacitement à ce qu’il vit. [...] Ces modifications joueront-elles dans le sens de plus de séduction ou de plus de distance, ou plutôt une combinaison des deux, je ne sais. Mais il est certain que le patient les perçoit, peu importe à quel niveau de l’inconscient ou du préconscient. Et il est aussi probable qu’elles l’aident à prendre conscience des sentiments et des souvenirs en question et à écouter et assimiler les interprétations verbales portant sur ce matériel auparavant inconscient.”
Harold SEARLES, “Préface à l’édition française: Une relecture” in L’environnement non humain, pp. 11-12.
Une bien belle leçon clinique….
Tags:environnement non humain, psychanalyse, searles

