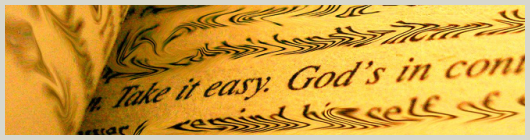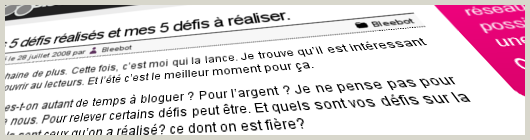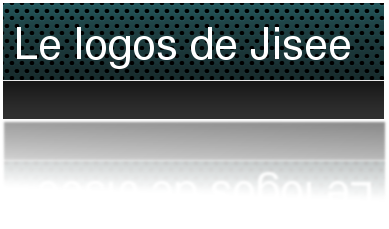Dieu le père en psychanalyse. Quoique !
Lors d’une lecture de malaise dans la civilisation (Freud 1929) mon attention fut retenu par cette hypothèse freudienne que le dieu monothéiste unique était d’essence paternelle. Autrement dit, la croyance en Dieu est une façon de questionner et mettre en scène le père. Et en croire la sacrosainte expression “Dieu le père” des chrétiens, on peut d’une certaine manière lui donner raison. Mais est-ce aussi simple ?
Freud en tant que Juif a bel et bien été élevé dans la culture hébraïque bien qu’il n’eut jamais vraiment reconnu l’influence de son judaïsme dans sa théorisation (exception faite peut-être dans Freud présenté par lui-même, 1924/1925). Et Pourtant l’art de l’interprétation du texte et du verbe fait partie de l’éducation spirituelle classique judaïque. Une des affirmations fortes concernant le Dieu des hébreux est celle de dire qu’au commencement était le verbe. Et que Dieu est davantage une instance nommante (les choses adviennent par leurs nominations) Ce dieu désigné par les 4 lettres du Tétragramme (YHWH) est aussi celui qui organise un Chaos. définit les règles et interactions. En ce sens il a fonction symbolique propre à la fonction paternelle telle que l’a définit Lacan. Néanmoins dans sa lecture psychanalytique de la Tora, Daniel Sibony (in lecture Lectures bibliques : Premières approches, 2007) précise que Dieu a plusieurs noms le deux principaux sont le Tétragramme (YHWH) et Elohym. Cette seconde acception désigne davantage un Dieu créateur, cause de la vie. Ainsi cette idée de donner la vie et de créer devrait à mon sens davantage être rattacher au maternel. Ainsi ce Dieu unique premier serait tout la fois maternel et paternel. Chez les chrétiens le maternel de Dieu fut d’abord refoulé (Dieu le père) puis déplacé vers une humaine : Marie. Ce déplacement s’opérant également sur ce qu’elle met au monde : Ce n’est pas le monde dont elle sera cause mais de son sauveur : Jésus. Si l’importance de la fonction maternelle demeure (mettre au monde le sauveur n’est pas rien) elle est inversée dans le temps : Elle arrive après le père. Pourtant dans des temps plus anciens les Déesses mères étaient belle et bien présente dans les religions polythéistes. Bien que polythéistes, il existait tout de même un culte unique en vers une Déesse mère dans certaines villes comme Ephèse*. Certains trouveront abusif d’affirmer que c’est déjà une forme de monothéisme pour le coup envers une déesse mère. En effet certains diront que choisir de vouer un culte en une seule divinité ne veut pas forcément dire qu’on nie les autres. Or cette seconde condition est nécessaire pour parler à proprement parlé de monothéisme. J’objecterais pour ma part que c’est déjà un premier pas.
Maintenant vous vous demandez pourquoi je parle de religion ? En fait je fais ce détour pour aborder un point crucial qui a été trop vite écarté par Freud : le sentiment océanique. Ce concept de Romain Rolland est selon lui ce sur quoi la religion se fonde. On peut résumer le sentiment océanique comme étant le désir de ne faire qu’un avec le monde de s’y fusionner en quelque sorte. Freud quant à lui prônant l’hypothèse suivante :
Pour ce qui est des besoins religieux, la dérivation à partir du désaide infantile et de la désirance qu’il éveille pour le père ne semble pas pouvoir être écartée, d’autant plus que ce sentiment n’est pas une simple prolongation de la vie infantile, mais est conservé durablement du fait de l’angoisse devant la surpuissance du destin.
S. Freud, Malaise dans la civilisation, PUF, Coll. Quadrige, 1995. p.14
Autrement dit Freud favoriserait le complexe d’œdipe qui met en scène la puissance du père sur l’enfant (car entre autre il écarte l’enfant de la mère). Pourtant la question du maternel archaïque qui est une autre manière de formuler le sentiment océanique a son importance dans toutes nos créations et non pas seulement religieuse. Par exemple l’espace même du web où l’on est connecté au reste du monde, où l’on surf dans un océan d’informations, peut tout à fait se décrire par un sentiment océanique (surtout lorsque nous voyons toutes les métaphores maritimes utilisées sur internet). Si Google fait office de fonction paternelle, l’espace même du web qui nous englobe tous, nous internaute, qui nous offre une grande source d’abondance, peut être comparable à une imago maternelle puissante, abondante mais aussi frustrante quand notre faim n’est pas rassasiée.
———–
* La particularité de Ephèse vouant un culte à Diane/Artémis est d’avoir longtemps été fidèle à une Déesse même après que L’empereur Constantin ait fondé l’église romaine. D’ailleurs, Freud parle de cette particularité dans “Grande est la Diane” des Ephésien” (1911) in Résultats, idées, problèmes, I
La chaine des 5 défis passés et futurs
Même sur le net il y a des us et coutumes à respecter. Notre raison nous indique qu’il n’y aurait aucun dangers à les transgresser Mais tapis au plus profond de notre inconscient un reste d’une pensée religieuse et mythologique, nous pousse à obéir sous crainte de … Non je ne préfère pas y penser. Mais sait-on jamais, les dieux peuvent être implacables au cas où ils existeraient. Les chaines de blogs ont ce pouvoir de suggestions prenant racines dans les plus archaïques superstitions même pour des êtres aussi civilisés que nous. Une autre lecture consisterait à dire que c’est pour s’amuser et au diable les analyses anthropo-psychanalytique de comptoirs. Et c’est pour cette raison que j’accepte volontiers l’invitation que m’a faite Christophe de répondre à cette chaine qui consiste en une prose à chanter les louanges de 5 défis qu’on a réalisé pour son blog, enchainées d’un second couplet de 5 défis à relever, un peu comme cette coutume des bonnes résolutions du nouvel an qu’on ne respecte jamais.
5 défis réalisés pour ce blog :
- Une ligne éditoriale enfin trouvée : En effet au début ce blog parlait de logiciels libres et de ubuntu, pour après évoluer vers un fourre-tout plus que raté. Après quelques mois je me suis enfin arrête sur la ligne éditoriale actuelle même si parfois j’élargis les thèmes (”fourre-tout”, “élargir” : je vous serais gré de vous abstenir de toute interprétation).
- Garder un ton personnel et libre : Attention l’adolescent en moi se réveille. Pourtant, dès lors qu’on parle d’une chose ô combien sérieuse comme la psychanalyse, il faut être sobre et adapter un ton universitaire. Oui mais ce blog est un blog, pas un article, pas un cours. C’est avant tout du plaisir.
- Un contenu d’origine d’appellation contrôlée : Ne voulant pas tomber dans l’information simple, ni même dans le recrachage de cours, je me suis donné comme horizon un minimun de créativité. Je dis peut-être des âneries mais j’assume en être l’auteur.
- Un design personnalisé : J’ai pendant longtemps utilisé des thèmes tout fait, sans rien toucher. Maintenant j’utilise un thème que j’ai pas mal modifié et bricolé. Trouver une identité visuelle c’est important je trouve
- Un espace d’échange : Je voulais que ce blog soit un espace d’échange. Dans l’ensemble mes chers lecteurs/commentateurs sont inspirés. Et c’est de ça dont je suis le plus fier (un peu démago mais c’est pourtant vrai)
5 défis à réaliser ou le complexe du nouvel an :
- Y en a marre des fautes d’orthographes : Cristallisation de la décadence du niveau d’étude ou résistance personnelle, il faut avouer que l’orthographe a tendance à battre de l’aile par ici. je vais donc me forcer à relire davantage avant de publier. Appelé également : syndrome du sale mioche qui est trop pressé de montrer sa production. Et je connais une amie qui n’aime pas les mômes. Donc gare à ma tronche.
- Améliorer le concept du blog : J’aimerais évoluer vers un concept mieux organisé avec plusieurs rubriques “psys” et dont chaque derniers billets sera mis en home page afin de leur garantir une meilleur lisibilité. Ceci impliquerait l’utilisation d’un thème type magazine avec une sorte de sommaire.
- Changer d’hébergeur avec un nom de domaine : Afin de jouir de plus de possibilité et pour améliorer le référencement de ce blog, il serait temps d’avoir un nom de domaine plus explicite et un hébergeur payant. Même si free me convient bien pour l’instant (gratuit et facile)
- Arrêter de parler autant du web 2.0 : j’ai ces derniers temps que trop parlé du web 2.0 qui n’intéresse pas les nombreuses personnes qui n’utilisent pas ce genre de services. le web ne se réduit pas à ça.
- Davantage garantir la mise en place d’un réseau de site “psys” : Cette année j’ai un peu participé au site psychoweb et à psychoring. Je pense qu’il faudrait mettre en place un réseau de blogs et de sites “psys”. Et favoriser les échanges inter-sites.
Bon voilà, il est temps pour moi de désigner 5 autres victimes pour cette chaine : Daria, Burning hat, Jean-Marie, Valentin et Max.
L’arobase : l’image primordiale du net ?
Cet article fut inspiré par une discussion avec Daria dans un article sur le vouvoiement sur le blog de Thierry Roget.
Il est intéressant de noter comment le arobase identifie d’emblée une activité de communication en ligne. Si son origine remonte à loin, son succès quant à lui est récent. Se prononçant « at » comme chacun sait, il renvoie aussi à l’idée de localisation (domaine : at free.fr, at gmail.com; temporelle : at midnight; spatiale : at home) et comme par extension il représente le message qu’on adresse à un autre (le « @ » étant dans toutes adresses mail, et que ce symbole en icône suffit à lui tout seul à évoquer le mail). Espace et direction : il est un message qu’on adresse au lieu (dans le lieu) d’un autre. Il prit par la suite, dans des outils, comme Twitter le sens de « je m’adresse à Mélanie » : « @mélanie ». Plus fréquemment encore le « à plus tard » peut s’écrire « @+ », induisant qu’on se reverra plus tard. On peut ainsi résumer le « @ » à l’idée de lien à un autre.
Maintenant, on peut se demander, pourquoi ce symbole plutôt qu’un autre ? Pourquoi ça à perdurer et surtout pour quelle raison ce symbole s’est étendu à d’autre contexte que celui d’une adresse mail. Dans un premier temps le “@” était après le non ou pseudo. Alors qu’une tendance actuelle le pousse à ce qu’il se retrouve devant. Je pense qu’il serait intéressant de suivre la voie graphique de ce symbole, qui est plus qu’une lettre de l’alphabet (car il n’évoque pas qu’un son) Il est presque un idéogramme. Il y a dans sa construction même une évocation de ses sens actuelles.
Quel bien étrange symbole qui visuellement ressemble à un « a » dans un « o » ouvert ( bien que selon les sources historiques il s’agissait d’un “d” pour le latin “ad”). Sur le plan graphique le « o » se constitue dans la continuité du « a ». Un fil part du bout du « a » qui l’entoure pour ensuite se diriger vers l’extérieur. Ainsi ce qui constitue l’enveloppe, est ce fil du « a » vers l’extérieur. Autrement dit, le « a » est enrobé par un espace qui tend vers l’extérieur. Un peu comme si son enveloppe était celle du lien à l’extérieur. Une autre formulation reviendrait à dire que c’est le lien entre « a » et autrui qui constitue sa propre enveloppe. Pour prendre une image c’est comme si le cordon ombilical du « a » constituait son propre ventre maternel. Espace où l’on se sent bien à priori. La question est de savoir si l’espace même du web se définie par du lien ?
En effet par ailleurs j’ai écris que sur internet un mouvement se faisait sans cesse entre un espace personnel et d’autres espaces. Le « home » étant sans cesse en lien avec soi et ailleurs. Cet « home » peut être sa page netvibes, igoogle, sa boite mail, son ordinateur. La plupart des services web ont un “home“. Même l’utilisateur le plus occasionnel passe par un point de départ (le « a » étant la première lettre de l’alphabet). Cet espace faisant office de représenter le Moi sur le web. Ainsi le succès du “@” peut s’expliquer comme représentation de nous-même pendant notre activité en ligne. C’est donc un signe avec une enveloppe et elle évoque une action. De par ce fait le “@” est d’abord une image. En effet si l’on suit la perspective de Serge Tisseron : toutes images se constituent d’un schème d’enveloppement et d’un schème de transformation (évoquant une action). On peut dès lors se demander si toutes images en renvoient à d’autres, alors à quelle image fondamentale le “@” peut-il renvoyer ?
Nouveauté : un bouton @reply pour chaques messages
Depuis quelques minutes vous pouvez voir une petite flêche ![]() à coté de chaque commentaires :
à coté de chaque commentaires :
![]()
Mais à quoi ça sert ce bidule ?
C’est simple : Vous cliquez dessus et le nom du commentateur apparait dans votre message sous la forme d’un “@pseudo_de_l’auteur”. Il y a deux avantages à cela. Premièrement plus besoin d’écrire le pseudo (bon en même temps un simple copié-collé suffit). Mais surtout lorsqu’on clique sur le pseudo apparu, on tombe sur le commentaire qu’on a voulu citer : pratique.
Pour ceux qui voudraient l’installer sur leur blog Wordpress:
Le plug in s’appelle “@ Reply”. Il est téléchargeable là. Il s’installe comme d’habitude : vous décompressez l’archive et vous mettez le contenu dans votre répertoire plugin. Puis vous l’activez dans le panneau des extensions. Pour finir il faut coller la ligne suivante dans votre fichier comments.php :
<?php if(function_exists("yus_reply")) yus_reply(); ?>
Sur le site wordpress il conseille de le coller avant :
<?php edit_comment_link
Rien de plus simple ![]()
Web 2.0 : influencer pour être vu
Avec l’arrivée des services de votes d’articles que sont les digg-likes, un nouvel enjeu est apparu pour les blogueurs préoccupés par leurs visibilités sur le net : être en homepage. Pour ceux qui ne connaissent pas ces services, le principe est simple : on soumet un article de son blog. Et certains selon différents critères vont se retrouver en première page. Être à la une en sommes. L’un des critères est le nombre de votes ou encore le nombre de liens pointant sur son article provenant des autres blogs (les backlinks). Il y aussi d’autres aspects qui échappent à la compréhension de chacun (sic).
Il s’agira alors pour chacun de se débrouiller pour avoir le plus de votes et de backlinks. Les stratégies d’influences qui sont ainsi mises en oeuvres, sont parfois loin des exigences de qualité ou d’authenticité que l’on pourrait attendre d’un blog. En effet, une expérience a démontré qu’un nombre élevés de votes influençaient le vote alors que sans, on obtenait des résultats différents et de façon aléatoire.
Ainsi, l’on voit pointer une interrogation sur l’échec de l’intelligence collective : Sur son blog, Bleebot, Christophe Levevre, décrit bien ce phénomène. Cette stratégie de visibilité et d’audience n’est pas sans rappeler la course à l’audimat de la télévision qui est dispositif spéculaire (image en miroir). Outre la critique que j’ai faite par ailleurs de cette dictature du grand nombre, j’aimerais insister sur l’interrogation suivante : Pourquoi vouloir être visible sur le net ? Est-ce lié au fait que derrière notre écran on ne nous voit pas ?
Comme je l’ai évoqué plusieurs fois, les processus psychiques mis en en œuvres sur le web répètent la construction de notre appareil psychique : comme par exemple le home qui est une métaphore du Moi, c’est à dire ce heim (équivalent allemand de home), cette demeure, pour reprendre le terme de Freud (cf “le Moi n’est plus maitre en sa demeure”).
S’il s’agit d’être vue le plus nettement (Net-ment) possible, on peut dès à présent se référer au stade du miroir de Lacan[1], qui avait fait de ce moment, une étape cruciale dans la construction de l’identité psychique. Autrement dit, il y a un enjeu d’existence : être vue pour exister dans le web. En effet Lacan nous explique que ce qui va constituer une identification primordiale du sujet est ce moment où il se voit dans le miroir, se reconnait et se voit comme une forme unifiée, alors même que son vécu corporel lui indique l’inverse : au niveaux des sensations ils se sent comme dissociés. Il y a quelque part là une anticipation par une image sur ce qu’il sera : il ne se sent pas encore comme un tout. Ce qu’il faut dans un premier temps retenir c’est que sur le plan identitaire, un stade crucial passe pour cette image spéculaire (image dans le miroir).
Mais quelle est alors le rapport avec le regard des autres ?
Pour répondre il faut décrire plus en détail le stade du miroir. En effet lorsque le jeune enfant voit son reflet, il ne le voit pas comme tel au début. Il voit quelque chose d’extérieur à lui, c’est d’abord un autre. Il va alors par la suite se rendre compte qu’il s’agit de son image. Il se voit pour le première fois. Mais ceci ne peut aboutir que si son impression est confirmé par une troisième personne. Le plus souvent la mère. Qui incarne à ce moment là une figure de ce que Lacan nomme le grand Autre. Le grand Autre qui peut prendre plusieurs figures a pour cette fonction de posséder une vérité sur le sujet, et n’ayons pas peur des mots : la vérité du sujet. C’est ce grand Autre qui reconnait et authentifie le sujet. Lacan dira que le grand Autre est le trésor des signifiants (c’est à dire des mots) du sujet car il est le garant des mots qui ont fonction de vérité sur le sujet, c’est à dire les mots qui le parlent. Cette vérité fait que fondamentalement le grand Autre c’est l’inconscient du sujet bien que la mère, le père ou d’autres peuvent en être des figures.
Du coup ce que signifie le stade du miroir peut se résumer de la façon suivante : Le rapport du sujet avec sa propre vérité (grand Autre qui reconnait, authentifie et nomme) passe par la relation avec sa propre image qui est au départ considéré comme un étranger. C’est le grand Autre qui par ses mots va dire « c’est bien toi. ». Si lors de cette première image de soi, on la voit d’abord comme étrangère, il faut ici comprendre que cette image de soi est perçu comme extérieure à soi : ce n’est pas moi mais son reflet. Ainsi ce jeu de regard avec le miroir maintiendra toujours cette ambigüité entre soi et un autre, entre intérieur et extérieur. Cette ambigüité passant par un jeu de regard qu’on pourrait aussi résumer e”n se voir être vu” fait qu’on verra toujours de soi dans l’autre et de l’autre en soi. On se voit toujours à travers le regard de l’autre mais c’est un regard qu’on produit. Cet axe en miroir, Lacan l’a appelé : axe imaginaire qui est un axe de l’identification. La façon dont on demeure dans cet axe détermine la façon dont on se voit mais toujours à travers ce regard de l’autre. « Si tous les regards sont tournés vers moi, si je suis plus visible sur le net, alors je me sens plus présent dans le web »
La question de son être au web, c’est à dire la façon dont on peut être sujet et exister sur le net, passe forcément par autrui ou plutôt comment on se voit à travers autrui. On peut alors comprendre en quoi un nombre importants de votes peut être un enjeu important. D’autant plus que cette image du miroir renvoie une image idéalisée de nous-mêmes : dans le stade du miroir, on se voit plus grand qu’on n’est et surtout unifié avant de se sentir comme tel par d’autres stimuli. Pourtant, si l’on passe par cet axe imaginaire de relation en miroir à autrui, ce n’est pas là que le sujet s’adresse. La question de savoir finalement à qui l’on s’adresse, et qui à avoir avec le grand Autre, est selon moi la question fondamentale pour comprendre ce qui se met en jeu sur le net via les blogs, le micro-blogging ainsi que tous les systèmes de communications et d’échanges sur le internet.
—————
[1] LACAN Jacques, « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je », (1966), in Ecrits I, Points Essais/ Seuil, Paris, 1970, pp. 92-99.
Mon mini Blog sur Tumbrl
 Petite note de service pour annoncer la création d’un mini-blog dont le flux est redirigé sur mon panneau latéral. Mais pourquoi un mini blog, me direz-vous ? Tout simplement je voulais aussi écrire des articles qui ne concernent pas forcément la ligne éditoriale de ce blog, y mettre des notes moins développer, partager des réflexions diverses et varier, partager des musiques et vidéos, faire des billets plus humoristiques etc. La plateforme utilisée est tumblr un service de micro-blogging très simple d’utilisation que je conseille à ceux qui veulent un service de publication sans fioritures, rapide et encore plus simplifié que ce qu’on connait déjà. Il suffit de s’inscrire, de choisir un theme et hop il suffit de publier. De plus il y a une dimension sociale dans le sens où l’on peut suivre les autres tumblr qu’on a ajouté dont les articles et donc les mises à jours se retrouveront dans son tableau de bord. Le seul défaut est l’obligation de passer par un service comme Disqus pour laisser à ses lecteurs la possibilité de laisser des commentaires. Mais ça reste simple à mettre en place.
Petite note de service pour annoncer la création d’un mini-blog dont le flux est redirigé sur mon panneau latéral. Mais pourquoi un mini blog, me direz-vous ? Tout simplement je voulais aussi écrire des articles qui ne concernent pas forcément la ligne éditoriale de ce blog, y mettre des notes moins développer, partager des réflexions diverses et varier, partager des musiques et vidéos, faire des billets plus humoristiques etc. La plateforme utilisée est tumblr un service de micro-blogging très simple d’utilisation que je conseille à ceux qui veulent un service de publication sans fioritures, rapide et encore plus simplifié que ce qu’on connait déjà. Il suffit de s’inscrire, de choisir un theme et hop il suffit de publier. De plus il y a une dimension sociale dans le sens où l’on peut suivre les autres tumblr qu’on a ajouté dont les articles et donc les mises à jours se retrouveront dans son tableau de bord. Le seul défaut est l’obligation de passer par un service comme Disqus pour laisser à ses lecteurs la possibilité de laisser des commentaires. Mais ça reste simple à mettre en place.
Une seule adresse à retenir : http://jisee.tumblr.com/
Blogs, traces et possessions
Pourquoi voulons-nous tant laisser nos traces sur le web ? En effet dans beaucoup de cultures la trace marque (en même temps une trace ne peut que marquer) la possession à quelqu’un ou à quelque chose : famille, clan, totem etc. Ainsi dans les opérations où l’on marque, la possession n’est jamais loin : marque de fabrique, marque démoniaque, armoiries. Ne dit-on pas : “c’est pas à toi y a pas marqué ton nom dessus” ? Oui l’écriture ne sert pas qu’à s’exprimer, ça n’en n’était même pas le but à l’origine.
Ici nous touchons à une phase de l’écriture avant qu’elle soit inféodée au langage oral et donc au primat du signifiant. En effet l’écriture est née en Mésopotamie. Et dans sa première phase uniquement sumérienne : l’écriture servait au dénombrement, à la comptabilité de ce que chacun possédait (nombre de vaches par exemple). Ce n’est qu’avec l’apport sémitiques des akkadiens que l’écriture prendra la double articulation du langage permettant l’expression des sentiments*.
Or la psychanalyse nous apprend que l’on garde trace des développements antérieurs. Ainsi dans les blogs ou dans les services de web 2.0 qui sauvegardent nos activités, garderions-nous pas une trace de la genèse de l’écriture ? Mais dans ce cas que chercherait-on à posséder avec le blogging ?
Et vous quels sont vos pistes ?
—————–
* Sur ce passage à la seconde phase, je vous invite à lire les travaux de Jean Bottéro, le plus spécialiste de la civilisation mésopotamienne
Danger de la blogosphère : museler plutôt qu’instruire ?
L’union européenne semble s’inquiéter du succès que rencontrent les blogs. Ainsi un projet de loi consisterait à noter les blogs afin de proposer une sorte de label qualité. On peut alors craindre que cette loi pourrait dériver vers une limite de la parole du blogueur. Surtout lorsqu’un député européen déclare:
“blogs sont aujourd’hui un puissant instrument de communication et peuvent être considérés comme une forme avancée de lobbying. Et constituer, en tant que tels, une menace.”
Ce qui fait peur serait une diffusion d’informations et d’opinions de manière massive et non contrôlée. Si faire l’opinion est un critère centrale dans une élection, on pourrait à notre tour craindre des dérives possibles d’une telle loi. Plutôt que de crier trop tôt à la théorie du complot, je me suis demandé quelle pouvait être la raison valable pour instaurer une telle loi. Autrement dit, en quoi une telle loi pourrait servir l’intérêt générale. Il est intéressant de noter soit dit en passant, que depuis Rousseau, nous sommes passé de « la volonté générale » (cf Le contrat social), à « l’intérêt générale ». Peuvent-elles coïncider ?
L’intérêt générale souvent se formule en terme de protection et de sécurité (du moins à notre époque). Le grand mot est la protection du citoyen. Dans ce cas quel danger porterait le succès de la blogosphère pour le citoyen ?
Ce qui inquiète les instigateurs de cette loi, c’est le fait que beaucoup d’informations sont diffusées sans nécessairement être vérifiées. De plus comment faire valoir un droit de réponse dans un tel amas d’informations ? sans oublier les mauvaises intentions qui pourraient se cacher derrière un buzz. Il est certain que les propos négationnistes et diffamatoires ont posé problème, par exemple dans wikipédia. Les dérives de ce types sont certes préoccupantes. Mais le muselage général est-il la seule réponse possible ?
A trop craindre la manipulation des masses, c’est le risque de trop infantiliser l’internaute qui se dessine insidieusement. En effet, on n’obtient rien de bon à maintenir le citoyen dans l’ignorance. Si internet peut véhiculer des informations erronées et mal intentionnés, il n’est pas non plus difficile de vérifier et de jauger la valeur d’une information. En effet, ce que pourrait craindre l’union européenne serait des phénomènes de masses déclenchés par une rumeur, une fausse information. La méthode du muselage a pour ce défaut de susciter la curiosité et bien pire la suspicion : « si on me cache quelque chose, ce n’est pas pour rien. On nous cache la vérité ». Dès lors, l’effet inverse se produira.
Une autre façon de faire serait d’instruire, d’apprendre à l’internaute d’avoir un esprit critique, de ne pas prendre tout pour argent content et surtout de savoir vérifier une information, de décrypter certains indices et surtout leur apprendre à chercher une information de manière pertinente. Or ceci doit pouvoir s’apprendre dés que possible. Et là l’école à son rôle à jouer. Pouvoir appréhender le monde de manière intelligible, n’est-ce pas le but de l’éducation ?
Des personnes comme Richard Peirano travaillent déjà dans ce sens et sont capable de proposer une telle formation. Victor Hugo disait “Ouvrez une école, vous fermerez une prison“. Écoutons, son sage conseil. La balle est dans le camp de l’état. Ne créons pas une dément-cratie.
Le web 2.0, du egroup sans parents ?
Dans un récent article Christophe Lefevre, faisait remarquer que Twitter, le service de mcro-blogging le plus connu, ne servait à rien en soi et donc pouvait servir à tout : échange d’infos, discutions, promotion de son blog etc. Si ce qu’on nomme web 2.0 ne se limite pas à microbloging, ce dernier en agrège plusieurs fonctions et peut servir de support à des services comme les digg-like, invitant ses contacts à voter pour ses articles. Mais ce qui fait la particularité de ces services de web social par rapport à des dispositifs de egroup plus anciens, c’est l’absence à priori de modérateurs et d’actes de modérations. De plus, je n’ai pas encore vu de personnes attaquer un groupe et qui fini par se le mettre à dos comme ça arrive parfois. Ceci n’ a rien à voir avec l’age puisque même des personnes plus avancé en nombre d’années peuvent agresser le groupe. Si dans les forums il y a des modérateurs alors que dans twitter non, est-ce parce que les services de micro-blogings n’en ont pas besoin ? Serait-ce là le vrai innovation du web 2.0 qui se veut être de web social alors que le net l’était depuis le début (les newsgroup existent depuis longtemps) ?
En effet dans des services comme twitter il est possible de choisir ses contacts et de les retirer comme bon nous semble. Chacun construit ainsi un espace de groupe dans sa home page. De plus, beaucoup de micro blogueur, sont des blogueurs et ne cherchent pas à se faire des ennemis. Il y a parfois la promo de son blog à assurer, une sorte de carrière dans la toile à développer.
Bien évidement le micro-bloging ne se limite pas à ça sinon cela deviendrait vite insupportable. Les échanges, les questions peuvent devenir assez riches et plaisants. C’est aussi une autre manière d’échanger avec les auteurs de blogs qu’on apprécient et qu’on découvre. Ceci créant un contexte où l’on s’automodère plus facilement.
Dans le développement de l’individu, progressivement et non sans mal, on intègre une loi celle des parents, celle du social. Le moment cristallisant ce conflit étant celle de l’adolescence. Pourrait-on dire que le web 2.0 serait le passage de l’adolescence à l’âge adulte, d’où le changement de nom ?
Il serait tentant de le penser (enfin un web parvenu à maturité, formidable !), mais il y a aussi un autre élément qui entre en jeu et que l’on ne peut pas sous-estimer. Cet élément, c’est la home page, un chez soi, sa demeure. Dans Twitter et autres, il y a un espace commun avec ses contacts, qui s’appellent souvent « home ». Dans les forum, l’espace commun, n’appartient pas à l’internaute.
Selon Freud, l’on cherche à maintenir un état d’équilibre en son sein : l’Homéostasie. (Homéo= semblable, Stase= position) Si je me permettais de faire de l’esprit, je dirais une stase du « home ».
Cet état d’équilibre où un compromis entre des pulsions contraires est trouvé, montre la tendance du Moi qui est la demeure du sujet à viser une certaine quiétude. Car nous le savons depuis « le moi et le ça » (Freud, 1923), le Moi est un diplomate, il cherche à satisfaire toutes les exigences, ce qui l’oblige à s’adapter et trouver des compromis. Le Moi se caractérise par son habilité à instaurer un cesser le feu. Il a dans cette fonction une valeur défensive et adaptative. Car c’est de son intégrité dont il s’agit. Nous n’avons aucun intérêt à polluer nos Moi/home du web, c’est à dire notre propre espace. Dès lors nul besoin de parents puisque nous sommes en notre espace notre parent. Ou plus exactement leurs lois y est intériorisés. On s’y identifie. Les micro-blog sont des espaces personnels même si l’on communique avec d’autres. D’ailleurs, le Moi met toujours quelque chose de lui dans autrui. Et y retrouve un peu d’autrui en son Moi. Ce fonctionnement en miroir n’est pas sans rappeler une des composantes même du fonctionnement psychique où il y a de l’autre dans le Moi. Finalement, l’apport du web 2.0 ne viendrait-il pas du fait que les développeurs ont mis en place un fonctionnement proche du notre ?
Ce qui est passionant dans le web ce que nous cessons de réinventer des nouvelles manières de communiquer et de dupliquer notre image. Le web est à notre image et nous le lui rendons bien.
Mon parcours numérique : une nouvelle chaîne ?
Suite à l’article de Yann sur son parcours numérique ainsi qu’à son invitation à en faire une chaîne, voici mon parcours numérique. Du coup j’invite d’autres blogueurs à retracer leur parcours numérique (@Daria : oui, oui du bon vieux narcissisme bloguien).
Du Bazooka au web 2.0.
Tout commença pour moi lorsque mon père m’offrit une super nintendo avec l’argent de ma première communion (les voiesdivines mènent à tout). Grâce à la religion, s’entama alors une grande histoire (d’amour ?). Je reçus ainsi une super nintendo avec le bazooka qui allait avec. Les phases de jeux ne dépassant pas les 10 minutes à moins de risquer une luxation de l’épaule. Les jeux livrés n’étaient pas vraiment intéressant mais ce n’était pas grave j’avais la super nintendo, la console qui venait de sortir en France et qui était la console à avoir. Très vite je me fis prêter deux jeux qui m’ont mis une véritable claque et marqueront à jamais mes souvenirs. Ce premier jeu fut Castlevania 4 : Superbes graphismes, musiques motivantes, maniabilité irréprochable. Pourtant, ceci n’était qu’une introduction. Ce fut avec encore plus de passion que je me mis à jouer à Zelda 3. Nul besoin, je pense, de présenter davantage cette saga.
J’eus dut attendre 3 ans avant de retrouver cette sensation avec secret of mana. Puis vint l’ncroyable final Fantasy 6 (le 3 en US). C’est à partir de ce jeu que je me mis à ne jouer quasiment qu’à des jeux de rôles. C’est avec la playstation première du nom que je vais pourtant jouer au meilleure titre de tous les temps. Ce jeu de rôle s’appelait Xenogear. Sa principale qualité : un scénario puissant, riche, complexe avec de nombreux rebondissements. Ce jeu très emprunt de psychanalyse (un héros gouverné par 3 instances, un personnage qui s’appelle Sigmund, une des réincarnations du héros se nommant Lacan etc.), restera un des plus cultes pour beaucoup (sa côte a même monté jusqu’ à 150€. Pour info, je l’avais acheté 20 €)*.
Dans le même temps je commençais à m’intéresser aux Pc et développa mes premières pages web (enfin c’est un bien grand mot). En 1999, les choses se faisaient souvent avec des frames et des calques (ça a bien changé depuis). Il faudra attendre 2005 pour que je me mette vraiment auxnet. Cette même année alors que je terminais mes études de psychologie, je me mis à fréquenter le forum de ma fac et je rejoignis assez vite son équipe de modération. J’ y resta 3 ans. En 2006 je crée le forum de la Coordination Nationale des Etudiants Contre le Décret sur la Psychothérapie, qui se fixait comme but de fédérer différentes formations en psychologie dans le combat contre la loi accoyer. En quelques mois son objet s’étendit pour devenir Upsy : l’union nationale des étudiants pour la liberté des pratiques. N’étant plus étudiants, je m’occupais surtout du coté technique et donnais bien sûr mon opinion. Toujours en 2006, j’ouvrais mon premier blog : psygnifiant.free.fr que je n’ai jamais vraiment alimenté. En 2007 vint un blog BD : métaphysique du poulet. Les BD étaient faites en vectoriel sous inkscape. Mais cela me prenait un temps fou pour finalement me rendre compte que je n’étais pas très doué. Quelques mois plus tard je créais le présent blog qui au départ parlait de logiciels libres pour évoluer progressivement vers le thème de la psychanalyse et de l’internet, thématique plus en cohérence avec mon métier et mes activités sur psychoweb.fr que je venais de rejoindre. C’est en 2008 que je me mis plus sérieusement a utiliser les services Web 2.0 comme Twitter, Jaïku, MyBlogLog, Vibstars et Blogasty et ainsi de découvrir une communauté francophone de blogueurs sympathique et dynamique.
———
* Ce jeu n’existant qu’en importation, fut très prisé à un moment donné où il était devenu rare dans les boutiques. Du coup la loi de l’offre et de la demande du marché de l’import en a fait grimpé le prix avant de redescendre fortement.