L’homme révolté n’est pas mort : du non au nom
Le sujet du non est un sujet du nom.
« Je me révolte donc nous sommes » Albert Camus in l’homme révolté, le sujet de l’affirmation puis du non est un sujet du social qui aboutit à la rencontre de l’autre comme différent.
Le sujet du non s’écrit aussi sujet du nom (il intéressant de noter qu’on retrouve « n » : haine ; et aime : « m »). Ce sujet dialectise et réunie haine et amour. Le sujet du non (nom) est forcément le sujet du désir, c’est le fameux « c’est pas ce que je veux ». C’est aussi parce que le sujet ne sait pas ce qu’il désir et que parfois se rendre compte que tel n’est pas son propre désir ne se fait qu’au prix d’une cure analytique ou d’une thérapie, que le sujet est divisé. Le sujet de désir s’affirmant dans le non (nom) peut demeurer autrement dans l’axe Imaginaire (”je ne suis pas à cette place”, “je ne suis pas ça pour toi”) et à la rigueur il y a autant de non (nom) qu’ il y a de manière d’être dans l’axe a-a’. en désenclavant l’axe Imaginaire le sujet rencontre le langage (nom et non sont des signifiants), et l’Autre.
Le passage du” je” au “nous” via le “vous” (ce “vous” à l’encontre duquel la haine première se transforme en “nous” par l’amour) ce ” nous” est la synthèse du “je” et du “vous” le “vous” de tous les visages de l’Autre.
Le non sépare le sujet de l’emprise de l’Autre auquel le narcissisme primaire nous fusionne. Le sujet décide d’abord de le détruire mais finalement l’intègre comme un sujet entiers et à part entière.
Ce qui transforme le “je me révolte” en “donc nous sommes” c’est un jeu de reconnaissance de l’autre et de reconnaissance par l’Autre, dés lors qu’il nous nomme on est sujet du nom.
la lettre lacanienne - Contre la normalisation
Contre la normalisation
Franck Chaumon, Roger FerreriUne pétition circule sur Internet, ouverte aux professionnels, aux institutions et aux citoyens, appelant à une forte mobilisation pour « sauver la clinique ». A la suite d’autres appels, elle témoigne d’un refus et d’une résistance qui s’organise face à ce qu’il faut bien nommer une normalisation des pratiques et des savoirs.L’espace de l’Université, tout comme celui de la recherche, est en effet l’objet d’une mise en cause fondamentale. Mais le fait que dans les universités de psychologie, une orientation de l’enseignement qui se réfère à la psychanalyse soit délibérément attaquée, manifeste la nature idéologique des affrontements actuels. Le fait nouveau est sans aucun doute le couplage de ces choix idéologiques avec des modes de gestion qui privilégient la programmation et l’évaluation des pratiques selon des procédures normalisées. L’empire de la nouvelle clinique du DSM s’étend d’autant plus efficacement que les critères de fonctionnement des institutions favorisent la gestion des populations prédécoupées selon ces critères. Les thérapeutiques cognitivistes sont d’autant plus privilégiées qu’elles se fixent des buts adaptatifs homogènes à l’idéal gestionnaire. C’est ce couplage qui impose sa logique dans les institutions et les services hospitaliers par l’évaluation des pratiques.De la hiérarchisation des psychothérapies par un rapport de l’INSERM au projet hygiéniste de prévention précoce de la délinquance, de la planification bureaucratique d’un plan de « santé mentale » à la réglementation de l’accès au titre de psychothérapeute une nouvelle biopolitique de l’intime s’instaure pas à pas. Aujourd’hui c’est l’Université qui est attaquée. Remarquons d’abord qu’elle l’a déjà été selon les mêmes lois de la logique gestionnaire : à l’Université hélas, comme en tant d’autres lieux, l’esprit de l’évaluation bureaucratique et comptable est passé, sans que lui soit opposée une résistance efficace. A présent une nouvelle menace se fait jour, visant le contenu même des enseignements avec la mise en cause de la présence de la psychanalyse dans les cursus de psychologie.Cette attaque nouvelle prend place par conséquent dans un ensemble plus vaste, et dans ce combat comme dans les précédents il convient de situer notre refus. Nous faisons l’hypothèse que dans ce contexte général la psychanalyse est attaquée du fait de son caractère antinomique d’avec la logique de la gestion postmoderne des populations. On peut en énoncer les points principaux d’affrontement : statut du singulier opposé à celui du particulier, statut de l’acte hors garantie, subversion du statut du savoir. La question de la réglementation des psychothérapies avait déjà soulevé la question, la mise en cause de l’Université la remet à l’ordre du jour. Or sa défense s’organise selon le mot d’ordre « sauvons la clinique », dans un raccourci qui nous semble fâcheux. Certes la normalisation de l’enseignement, et précisément l’attaque de celui qui se fait en référence à la psychanalyse, participe d’une normalisation des pratiques. Mais « la clinique » ne saurait être identifiée à l’enseignement des étudiants, et ceci d’autant plus qu’il s’agit ici de psychanalyse. De fait, « la clinique » a déjà été mise à mal, sous les coups de la normalisation tous azimuts.L’initiative du SIUERPP est heureuse, elle lance un combat pour l’Université et à ce titre elle est l’affaire de tous. La volonté de conjuguer cette résistance avec celles déjà engagées par des praticiens libéraux ou dans les institutions est bienvenue. Mais il importe de le faire dans la clarté. Que les temps soient durs, que la résistance doive être déterminée, qu’il soit nécessaire de s’unir n’implique pas que l’on doive simplifier à l’excès voire gommer les difficultés, bien au contraire.Lucien Bonnafé nous en avait, en son temps, averti : « Dans la lutte contre la malfaisance de la pensée fétichisée, il n’est pas indifférent que nous laissions des traces de nos soucis. » Effectivement l’invocation de la clinique ne saurait se faire sans qu’on y laisse des traces de nos soucis. Sauver la clinique, projet salutaire autant qu’impossible, ne saurait être si rapidement réduit à la formation des dits cliniciens, personnes identifiées par la validation d’un cursus d’enseignement psychopathologique et/ou psychanalytique.Que l’université ou toute autre forme d’enseignement intègre la question de l’accès aux savoirs issus de la psychanalyse est heureux et signe sa présence vivante dans notre pays, situation on le sait originale. Mais donner à penser que cela suffise à sauver la clinique est un raccourci dangereux.Il y a tout d’abord une difficulté liée à l’énoncé. « Sauvons la recherche », mouvement dont on suppose que le libellé est à l’origine du choix de celui de la présente pétition, revendique de préserver la liberté de « la » recherche, c’est à dire de l’exercice des recherches dans la diversité de leurs orientation. Par contre « Sauvons la clinique » semble soutenir que seule une « clinique psychanalytique » (« psychopathologique » ?) mériterait un tel privilège. Or il n’y a pas « la » clinique mais des cliniques : il existe, bien sûr, une clinique comportementaliste, une clinique cognitiviste, une clinique du DSM. Si cela est vrai, existe-t-il une distinction essentielle entre l’une et les autres ? La question mérite d’être posée. S’il y a une différence radicale, de quelle nature est-elle ? Est-ce qu’elle tient au contenu des enseignements ou à autre chose ? La clinique inscrit-elle toujours la même position d’asymétrie entre celui qui parle et ceux qui l’écoutent ? Une «clinique psychanalytique » découle-t-elle, se déduit-elle d’un enseignement de la psychanalyse à l’université ? La question n’est pas mineure : ne peut-on dire en effet que la cure psychanalytique inverse l’asymétrie constitutive de la clinique bâtie jusque là ? Le choix originaire de Freud n’a-t-il pas été d’imposer à qui voulait le suivre de prendre la place de l’hystérique ? Cet « à l’envers » qu’instaure la psychanalyse n’est-il pas rien d’autre que son « non enseignable » ? Ecouter c’est attendre un savoir à venir dans la parole de l’analysant et non l’anticiper dans quelque savoir que ce soit. S’il y avait une clinique psychanalytique, ne serait-ce pas son principe fondamental ? Et dans ce cas, cela se déduirait-il d’un enseignement universitaire ou bien de l’expérience que chacun peut faire dans la cure ?Questions difficiles sans doute, et qui méritent débat, mais qui de ce fait ne sauraient souffrir d’être gommées au nom de l’urgence militante. Est-ce qu’il faut défendre l’existence de la psychanalyse à l’université ? Oui bien sûr. Mais nous savons bien que la psychanalyse est menacée dès aujourd’hui d’être enserrée dans des procédures d’évaluation directes et indirectes, notamment par le biais de la réglementation des psychothérapies. Or tous les protocoles, toutes les procédures sont fondées sur l’évaluation des savoirs. Est-ce là le cœur de la psychanalyse ? Non bien sûr.Le passage de la psychanalyse dans la culture n’est pas superposable à celui des sciences humaines, où les savoirs constitués en disputent aux rhétoriques politiques, il tient aux effets de sa transmission à l’envers des savoirs, transmission qui ne saurait être restreinte à la stricte formation des psychanalystes. Pour le dire autrement les constructions singulières de l’hystérique, déclenchées sous ce mode, n’ont pas vocation à soutenir une psychologie puisqu’elles se sont historiquement constituées en réaction à l’idée même de psychologie. Le passage dans la politique de ce nouveau mode d’expression du singulier objecte à toute possibilité d’occuper le terrain des contenus référentiels pour le collectif.La psychopathologie, aussi intéressante soit-elle, nous semble toujours viser à construire un regroupement d’oreilles propre à soutenir un agencement anticipé du recueil de la parole. Freud en inventant l’inconscient, a ouvert de nouvelles voies, un nouvel espace entre la bouche et les oreilles. Par effet de culture cela permet au clinicien un soutien jusqu’alors méconnu pour ne pas être le simple officiant de la clinique, soit l’agent d’un retour forcené des dernières constructions de l’observable pour bien ficeler l’observé.En ce sens, la clinique est une invention de la transmission des savoirs sur l’humain, c’est même une invention de la Faculté, peu importe laquelle. Tant mieux que des universitaires se battent et en appellent au peuple pour soutenir les choix qui relèvent de leurs débats. Tant mieux pour nous qu’aux personnages près, leurs disputes soient en écho avec nos préoccupations. Mais laisser croire à cette relation simpliste entre sauver la clinique et enseigner la psychopathologie et la psychanalyse est abusif. Les enseignements n’impliquent pas les pratiques. Les énoncés issus de la psychanalyse peuvent, comme les autres, servir de prescriptions normatives s’ils s’imposent comme savoir avant toute rencontre. Il est aisé de constater par exemple que le complexe d’Oedipe peut fonctionner comme une proposition politique, avec laquelle on juge l’air du temps voire on prétend ordonner une clinique réputée « nouvelle ».Il suffit de se promener dans les prétoires pour voir combien d’expertises rédigées par des cliniciens formés à la psychopathologie et à la psychanalyse font œuvre au quotidien de discours moralisants, bien plus grotesques et malfaisants que ceux que Michel Foucault avait qualifiés en son temps. Nous n’incriminons pas l’enseignement qu’ils ont reçu comme cause de ces élucubrations, ce que nous affirmons ici c’est qu’un enseignement, aussi ouvert et critique fut-il, ne saurait à lui seul protéger de ces déviances.Que la psychanalyse participe aujourd’hui – à l’insu des psychanalystes ou non – à la constitution d’une clinique normative, démontre que sa subversion ne doit pas être tenue pour acquise. Ce combat n’est pas nouveau : il faut rappeler qu’elle s’est constituée historiquement contre les effets étouffants de l’assujettissement aux sciences humaines. Personne n’échappe à la théorie, et la théorie analytique n’est jamais qu’une théorie du sujet qui échappe à la théorie et pour laquelle le cantonnement aux contraintes de la langue a le mérite de rappeler avec insistance la pointe éthique de l’extension de ses effets. C’est au point même que l’on pourrait renverser la proposition et soutenir que la question n’est pas de sauver la clinique mais de permettre au clinicien d’œuvrer malgré la clinique, pour ne pas dire contre les cliniques. Tout diplôme de clinicien n’est jamais qu’un diplôme autorisant à se confronter dans des circonstances variées à la clinique, lesquelles circonstances font partie intégrante de la clinique.Défendre la Recherche contre les manœuvres diverses d’assujettissement dont elle peut être l’objet est un combat essentiel, tout comme l’est la défense de l’Université dans sa pluralité. Chacun peut l’entendre et s’y reconnaître, mais mieux vaut encore en expliciter la complexité pour que cela puisse nourrir le débat public.Les chercheurs ont su montrer qu’ils pouvaient être menacés dans leur métier par la pression d’intérêts publics ou privés. Les universitaires et les étudiants peuvent faire valoir que les règles de l’université doivent s’appliquer aussi dans les départements de psychologie. Avec les praticiens, ils peuvent montrer l’urgence d’une mobilisation de tous contre la normalisation généralisée.
la lettre lacanienne - annonces
Crédits aux auteurs,
De cette lettre dont je partage pleinement les arguments. J’aimerais insister notamment sur le fait que l’université se fait là un peu trop rapidemùent et exclusivement le porte parole de la psychanalyse. Or elle appartient aux psychanalystes. Ainsi peut-on vraiment, considérer raisonnablement que l’université enseigne la psychanalyse?
bien sûr que non, et là dessus, les universitaires sont les premiers à le dire. Aprés qu’est ce que de la psychanalyse, à l’université est enseigné, transmis?
Pour ma part, ce que j’ai pu lire des séminaires de Lacan, qui a une façon de transmettre très loin de la pédagogie universitaire, m’ont bien plus apporté dans ma façon de questionner, me questionner dans la clinique.
Maintenant, ce qui reste ouvert encore pour moi est la question suivante: Le discours du psychanalyste peut-il exister dérrière le discours de l’universitaire ? et si oui, ne serait-ce pas une question pour l’étudiant, de gratter, de voir dérrière un masque, celui du symptôme?
Les silences du clinicien…
Souvent l’on reproche aux psys d’orientations analytiques de ne pas parler. En effet, face à certains patients ou à certains moment, le silence, au contraire semble empêcher d’ inviter le patient à dire. Comme s’il fallait une sorte de parole contenante pour mettre en confiance le patient, pour qu’il se sente à l’aise. Autrement dit, assurer une certaine position qui indiquerait que là une parole peut être, enfin, entendu et authentifié: quelque chose là peut enfin être reconnu. Ceci fait par exemple partie de ce qu’on nomme à tour de bras: le cadre thérapeutique.
Ainsi, j’ai longtemps pensé que cette mise en oeuvre devait passer par la parole étayante, rassurante du clinicien qui prendrait dans le transfert parental, le role d’instance nommante: un signifiant faisant advenir les autres. Cette mise en filiation se voulant faire advenir le sujet, pas celui du symptôme, mais celui du désir, est typique d’une façon de mener les entretiens avec les adolescents et jeunes adultes où le clinicien de par sa personnalité à tendance à se mettre à une place paternelle.
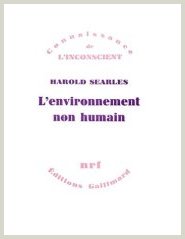
Mais voilà, si l’on ne veut pas être le maître du discours du patient, et laisser justement ce dernier entendre sa propre parole, il faut lâcher une certaine maîtrise. En d’autres termes, il n’est pas toujours possible de savoir quand fermer sa bouche et quand notre parole empêche celle du patient.
De de fait, je pensais naïvement que ce travail de juste équilibre se situait au niveau de la qualité de la parole du clinicien, c’est à dire, parler au bon moment, au bon rythme entre parler et se taire et que ceci dépendait du choix juste des mots avant de se taire.
Pourtant s’il y a une variété des paroles du clinicien, il y a surtout une variété de silences, tout les silences ne se ressemblent pas: il y a plusieurs types de silences. C’est en lisant L’environnement non-humain de H. Searles, que je me suis rendu compte de cette évidence: il y a silence et silence.
Je ne peux m’empécher de citer un passage du livre:
“C’est une illusion facile à entretenir pour l’analyste que de croire maintenue, tant qu’il garde le silence, la neutralité affective chère à la tradition analytique classique. Il aurait au contraire intérêt à se rendre compte de ce que les diverses réactions transférentielles du patient à son silence ont, selon toute probalité, un fondement significatif dans la réalité et la qualité de ce silence. [...]
J’ai maintenant la conviction que quand j’ai découvert chez un malade un conflit en grande parte inconscient sur lequel je garde un silence [...], cette découverte même transforme ma capacité de réagir ou de participer tacitement à ce qu’il vit. [...] Ces modifications joueront-elles dans le sens de plus de séduction ou de plus de distance, ou plutôt une combinaison des deux, je ne sais. Mais il est certain que le patient les perçoit, peu importe à quel niveau de l’inconscient ou du préconscient. Et il est aussi probable qu’elles l’aident à prendre conscience des sentiments et des souvenirs en question et à écouter et assimiler les interprétations verbales portant sur ce matériel auparavant inconscient.”
Harold SEARLES, “Préface à l’édition française: Une relecture” in L’environnement non humain, pp. 11-12.
Une bien belle leçon clinique….
ePsychologie » CAPTCHA
Nov 24th, 2007 by Yann Leroux
Un nouveau dispositif s’est implanté sur le réseau Internet, et probablement pour longtemps. Il demande à l’utilisateur d’effectuer une petite tache (un calcul, recopier une succession de lettres. La tache est parfois introduite par une excuse interrogative : “Etes vous humain ? Désolé, nous devons savoir”. Nous sommes donc ainsi ammenés à faire la preuve de notre humanité devant une machine.Le dispositif en question est appellé CAPTCHA pour “Completely Automated Public Turing test to Tell Computers and Humans Apart », qui peut être traduit par « test public de Turing complètement automatique ayant pour but de différencier les humains des ordinateurs” Alan Turing est un mathématicien qui a imaginé une épreuve pour discriminer les humains des machines (1). Dans cette épreuve, un sujet a une conversation avec deux interlocuteurs. L’un est un humain, l’autre est une machine. Le sujet doit découvrir l’identité de chacun. Il a comme information que l’une des deux entités souhaite qu’il découvre la vérité et que l’autre tente de l’induire en erreur. Pour Turing, si le sujet n’arrive pas a différencier ses interlocuteurs, cela est la preuve que la machine est intelligente. Il avait imaginé ce test pour montrer que les machines peuvent accéder à un fonctionnement qui était considéré jusqu’alors comme l’anapanage des être humains….
Lire la suite:
ePsychologie » Blog Archive » CAPTCHA
Mini manuel de recherche bibliographique en psychanalyse
Souvent lorsqu’un étudiant en psychologie doit trouver des références bibliographiques sur un thème précis, il se trouve devant une certaine difficulté. En effet, s’il n’est pas difficile de trouver des ouvrages sur un terme ou une notion psychologique ou psychanalytique, lorsqu’il s’agit d’une notion plus générale et pluridisciplinaire, ça devient plus difficile.
la première méthode qui vient alors est la prospection auprès des profs, des professionnels ou des camarades. Cette methode trouve très vite sa limite.
En souvenir de mes galères d’étudiants pour me constituer des références d’ouvrages pour la rédaction de mémoires, je livre ici ce qui a finit par devenir une méthode assez efficace. Ce billet se centre sur la recherche en psychanalyse, mais ses principes peuvent être adaptés à d’autres champs.
~
I- L’acharnement sur un terme est une perte de temps
En effet, définissez bien le champs lexicale et sémantique de votre notion et faites vos recherche sur ses termes étendus. Ce préalable nécéssite aussi de travailler sur les notions techniques qui peuvent être associées à votre terme. Par exemple si vous faites un mémoire sur l’adoption (réference au mémoire d’une certaine cilou ![]() ), il sera pertinent de chercher aussi du coté des notions de fantasmes des origines, de roman famillial, de filiation et transmission etc.
), il sera pertinent de chercher aussi du coté des notions de fantasmes des origines, de roman famillial, de filiation et transmission etc.
Ainsi, on peut d’emblée distinguer deux types de termes: généraux et techniques (propre à la psychanalyse, dans notre cas).
~
II-Les dictionaires de psychanalyses
Que vous cherchiez des termes techniques ou généraux, les dictionnaires de psychanalyses vous renverront à des textes.
- Le dictionnaire international de la psychananalyse , sous la direction de Alain de Mijolla, a l’avantage de renvoyer à des textes que les termes cherchés soient propre à la psychanalyse ou généraux (du moment que ça peut interresser la psychanalyse)
- L’apport Freudien, de Pierre Kaufmann est un dictionnaire pour les notions Lacaniennes, qui renvoie aussi à des textes.
- Pour les textes et notions Freudiennes, il y a le très célèbre, vocabulaire de la psychanalyse, de Jean Laplanche J-B Pontalis.
Les textes qui seront indiqués renveront à d’autres textes .
C’est déjà pas mal là mais ce n’est pas suffisant, il peut arriver que vous ne trouviez pas grand chose. La solution qui vous reste est de consulter les catalogues et collections en lignes.
~
III-Base de donnée, l’art du mot clé
Evidemment, tout le monde connait le principe de taper un mot clé dans une base de donnée ou un moteur de recherche. Le vrai problème est de savoir dans quel base de donnée, taper sont mot clé.
Pour la psychanalyse, il existe une base de donnée très complète, celle de la bibliothèque S.Freud de la SPP:

Il est possible de rentrer ses mots clés selon l’auteur, le termes etc.
La rubrique “recherche documentaire” permet de faire une recherche plus précise.Il est conseillé de mettre quelques précisions mais pas trop car cela risque de trop fermer le champ de recherche, voir de donner aucun résultat.
Si vous avez la chance de pouvoir vous rendre à Paris, il est possible d’ajouter les livres retenus à un panier, puis d’aller à la bibliotheque Sigmund Freud 15, rue Vauquelin - 75005 Paris (métro Censier-Daubenton).
Aprés avoir tapé votre mot clés, vous arriverez sur une page avec les reférences bibliographique, il est possible de cocher sur les textes qui vous parraissent pertinent.

Après avoir coché ce qu’il vous fallez. Cliquez sur ajouter à votre panier.


Attention:
Il est impératif de faire “ajouter au panier” à chaque fois que vous changez de pages. Sinon vous perdrez tout.
Ce qui serait bien domage ![]()
Ensuite il faut cliquer sur “Mon panier”:

Pour imprimer la page: “Affichage pour impression”

Si vous ne voulez pas imprimer, notez juste la référence entre [] avec e numéro à coté:

Maintenant vous n’avez plus que donner les ref à la documentaliste de la biblioteque pour qu’elle vous apporte les livres.
Il existe d’autres catalogue de bibliothèque disponible en ligne:
- Système universitaire de documentation
- Le catalogue de la Bibliothèque Sainte Genevieve
- Le catalogue de la BPI (Centre G. Pompidou)
Et bien sûr il reste google ;).
Documentaire: Nom de code Linux
Voici un documentaire d’Arte sur Linux qui est plutôt bien fait et interressant:
Nom de code Linux (veuillez apprécier au passage ce superbe jeu de mots ![]() )
)
Vous pouvez lire sur youtube les 5 parties: >>Lien<<
Où les visionner directement ici:






















